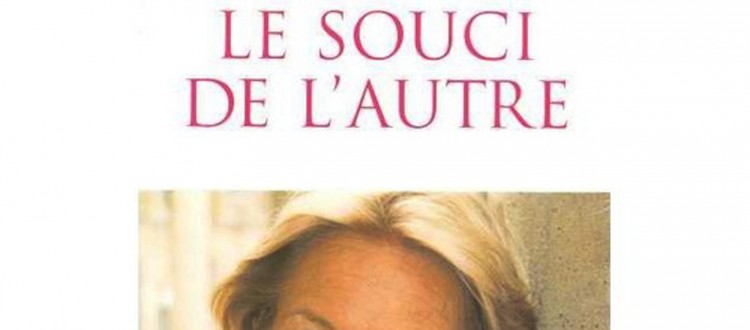de Bruno Blaise
Pour la première fois, l'auteur de « La Mort intime » élargit le champ de sa réflexion et de son témoignage à un sujet qui nous concerne tous : la place de l'humain dans le monde hospitalier français. Trop longtemps – et encore aujourd'hui – les problèmes posés par le système médical français, et l'hôpital en particulier, ont été réduits à des problèmes de matériel, de budget, de personnel, d'organisation. Ce livre montre le véritable enjeu : le malade en tant que personne. Une révolution de la relation humaine doit se produire au-delà de la technique, quelle que soit la réalité des problèmes administratifs ou budgétaires : il faut que chaque patient trouve sa place et se sente accepté en tant qu'être humain par les soignants. Maternités, services d'urgence, unités de soins palliatifs, services de cancérologie, hôpitaux de province : Marie de Hennezel a visité ces lieux où se décide notre santé et interrogé ceux qui y travaillent. Elle y a constaté la réalité d'un désarroi, chez les patients comme chez beaucoup de soignants. Elle multiplie les suggestions touchant à de nombreux domaines, depuis les bases de l'enseignement médical jusqu'à la pratique hospitalière au quotidien. Un constat accablant, parfois humainement bouleversant, en même temps qu'un appel à chaque citoyen à construire la véritable « démocratie du soin ».
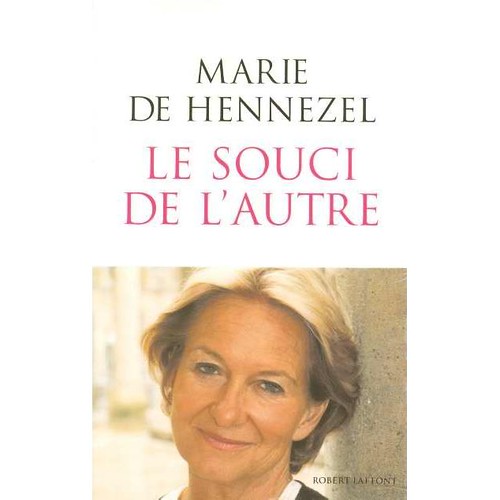
Responsable d’autrui
« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » disait Terence. Ce « souci de l’autre » qui est le propre de notre humanité, j’ai voulu l’aborder ici à partir d’une situation qui nous concerne tous : la situation de vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables, de la femme sur le point d’accoucher au mourant, en passant par tous les éclopés de la vie.
Un grand nombre de lettres, de témoignages, de rencontres m’ont permis de constater le processus déshumanisant qui partout lamine les efforts de ceux qui tentent de préserver les valeurs du soin.
Mais j’ai découvert aussi que des médecins et des soignants fidèles à leurs valeurs humanistes, sont conscients de leurs responsabilités vis-à-vis des plus vulnérables. J’ai découvert que les malades eux-mêmes, au-delà de leurs exigences et de leurs plaintes, savent comprendre la vulnérabilité de ceux qui les soignent.
Enfin, les lieux où l’on soigne avec humanité se multiplient.
Il sera donc question ici de cette vulnérabilité qui nous est commune, du fait que nous sommes tous des humains mortels, de cette responsabilité qui nous incombe aux uns et aux autres, celle de garder allumer la lampe du « souci de l’autre », aussi vacillante soit-elle.
1. De l’autre côté de la barrière des bien portants
Mis à leur tour dans la situation des malades, les médecins comprennent alors ce qui fait du bien et ce qui n’en fait pas. Le jour où ils reprennent leur activité, ils n’approchent plus leurs patients de la même manière. « Croyez-moi, lorsqu’on est dépendant, incapable de communiquer par la parole, les mains attachées et qu’on a des douleurs dans tout le corps, le plus important, ce ne sont pas les perfusions et les pansements, mais bien plutôt un sourire, un regard, une information rassurante et une main qui ne vous considère pas comme un objet, mais comme une personne. C’est là que la démarche de soin prend tout son sens » écrit Élisabeth à un infirmier.
La profession d’infirmière bouscule ! Il est clair que la confrontation avec un être qui souffre confronte à soi-même.
Trop de médecins considèrent encore aujourd’hui qu’ils n’ont pas fait des études de médecine pour écouter les malades, ni pour s’asseoir à côté d’eux et leur tenir la main. La plupart des médecins ne savent pas écouter ni dialoguer. Personne ne leur a appris. Ils ne se sentent pas prêts pour affronter l’attente des malades, parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment armés pour faire face à leurs propres angoisses ou à leurs propres émotions face aux patient.
2. Donnez-nous une médecine humaine !
Une médecine humaine se préoccupe du malade avant de se préoccuper de sa maladie.
On ne peut pas passer sous silence le témoignage de Jean de Kervasdoué (directeur des hôpitaux de 1981 à 1986, actuellement professeur d’économie et de gestion des services de santé au CNAM), hospitalisé récemment à la suite d’un accident. A travers un récit sans complaisance, non dénué d’humour, celui qui a toujours vu l’hôpital d’en haut, nous fait découvrir ses multiples dysfonctionnements. Ce dont les malades souffrent tous les jours : les attentes interminables, la douleur que l’on tarde à soulager, l’angoisse de ne pas savoir ce que l’on a, ni ce qu’on va vous faire. Il témoigne aussi des « longs moments d’abandon » qui succèdent « à l’intense et réelle attention de quelques instants », des rapports de force entre celui qui est couché et celui qui est debout.
La négligence va de l’absence de matériel adéquat aux radios que l’on égare dans le dossier. Mais elle n’est pas seulement matérielle, elle est aussi humaine.
La lecture du Livre blanc des premiers états généraux des malades du cancer (1998) devrait faire partie de la formation de tous les futurs médecins. Ils apprendraient beaucoup sur les vrais besoins des malades, sur leur lucidité et leur capacité à porter leur maladie, sur leurs ressources.
« Ne pas dire la vérité, c’est nous enlever notre dignité, ne pas nous donner les moyens de nous battre », dit un malade.
« Le médecin doit annoncer le cancer avec humanité, comme il l’annoncerait à sa femme », affirme un patient.
Le dialogue, le contact direct sont essentiels. Le malade a besoin d’être informé.
Les médecins disent souvent qu’ils n’ont pas le temps. J’en ai pourtant vu, tout aussi débordés que les autres, s’asseoir quelques minutes au chevet de leurs patients au lieu de rester debout, prêts à partir. Ce simple geste donne le sentiment à l’autre que l’on est disponible pour lui. Le malade a besoin de se sentir partenaire de sa guérison et d’être traité comme une personne. Le mot solidarité revient toujours dans la bouche des malades. Ce besoin de sentir que l’on n’est pas seul, que les autres vous soutiennent, vous accompagnent. Quand quelqu’un vous parle, vous accompagne, on se sent plus fort, on reprend espoir.
La parole aux familles
Parce que la maladie bouleverse les relations que le malade entretient avec son entourage, elle a une dimension sociale qu’il faut prendre en compte. Le patient dit souvent son désir de rassurer sa famille et sa peur d’être une charge pour elle. J’ai souvent eu le sentiment qu’il suffisait d’un peu d’écoute et de disponibilité à leur égard pour que les proches deviennent des partenaires de soins.
De la violence dans les soins
La violence dans les soins peut être physique, lorsqu’un soignant entrave la motricité d’un patient en l’attachant dans son lit. Elle peut également être psychologique : les injures, la familiarité déplacée, les menaces, le chantage.
3. Pourquoi ce mépris de l’humain ?
Nous nous trouvons devant un paradoxe absurde. D’une part, les pouvoirs publics ont décidé de mettre « le patient au centre du système de soins » et la loi reconnaît maintenant les droits des malades à l’information, au dialogue, au respect, à la considération, à « une vie digne jusqu’à la mort ». D’autre part, l’évolution même de la médecine, ainsi qu’une série de décisions politiques, depuis quelques années, notamment la réforme du temps de travail, vont plutôt dans le sens d’une déshumanisation des soins.
L’hôpital entreprise
Il semble bien que l’entreprise hospitalière soit au bord d’une double faillite économique et humaine. Pendant plus d’un millénaire et jusqu’en 1950, l’hôpital était une institution charitable, tenue par les ordres religieux. Il accueillait les plus pauvres. Une personne de classe aisée naissait et mourait chez lui. Depuis 1950, la médecine a fait plus de progrès qu’en 500 ans. L’hôpital est alors devenu le lieu presque obligé de la naissance, de la maladie et de la mort.
Des transformations sociologiques ont contribué à cet afflux massif des malades vers l’hôpital. Les familles se dispersent, le travail des femmes, la vie dans des logements exigus ne permettent plus de garder à domicile un grand malade, à fortiori un mourant. Très vite, l’opinion publique a compris que l’hôpital était le lieu où il fallait se rendre si l’on voulait guérir. L’hôpital regroupe aujourd’hui plus de 100 spécialités et une centaine de métiers différents. Les problèmes d’organisation sont privilégiés au détriment de la relation humaine. On comprend que les professionnels de la santé, dont on ne valorise plus que l’efficacité et la rentabilité, finissent par négliger ce qu’ils appellent le « relationnel » me fait remarquer Jean de Kervasdoué.
La gangrène administrative
Il y a aujourd’hui plus d’administratifs que de médecins dans les hôpitaux. Il faut également inclure les 10 ou 20 % du temps des infirmières et des médecins passés à nourrir de papier cette machine folle. La multitude des administratifs n’est là que pour transmettre chaque jour à l’administration centrale les milliers d’informations, calculs, états, comparaisons, prévisions, estimations, évaluations, rapports qu’elle sollicite… pour justifier son existence. Elle est là aussi pour diffuser dans l’autre sens les centaines de lettres et circulaires émanant des différentes directions.
Pénurie de moyens, pénurie de médecins et de soignants
On manque de soignants. On manque aussi de médecins. Et la situation ne va pas s’améliorer. Entre 2005 et 2015, 1 hospitalier sur 2 partira à la retraite, alors que la demande augmentera avec le vieillissement de la population. Comment humaniser l’hôpital quand on vous coupe tous les moyens de le faire ?
Lorsque que je leur ai demandé leur avis sur les 35 heures, les directeurs d’hôpital ont tous confirmé qu’il s’agissait d’un « véritable séisme ». Bernard Kouchner lui-même le reconnaît. Le gouvernement aurait dû proposer un moratoire, prendre son temps. Au lieu de cela, il a désorganisé l’hôpital et brisé la vocation médicale. Le directeur de l’hôpital Saint-Joseph me confie : « Avec les 35 heures, même les médecins comptent leur temps. Ils ne le faisaient pas avant. Je ne programme plus de réunion le vendredi, parce que la moitié est en RTT. »
Une médecine de plus en plus technique
Dans Libération du 23 février 2003, Didier Sicard, président du Comité consultatif national d’éthique critique vivement une médecine ivre de technologies, qui perd le contact avec le corps et ne sait plus écouter le patient. Un premier effet pervers de la confiance excessive dans la technique est qu’on ne fait plus du tout confiance à ce que le corps ressent, ni à ce que le sujet dit de son corps. Un 2e effet pervers est qu’elle provoque une obsession du dépistage et de la prévention qui finit par créer de l’angoisse.
La spécialisation à outrance, le progrès technologique ont contribué à la dévalorisation progressive du métier de généraliste, un métier, précisément, où l’écoute du patient, son examen clinique était de la plus grande importance.
Des soignants vulnérables
Le mot d’ordre des manifestations infirmières des dernières années, « Ni bonnes, ni nonnes, ni connes ! » exprime la lassitude et la colère d’une profession qui ne se sent pas reconnue ni valorisée. Cette absence de prise en compte de la dimension humaine, vulnérable, des soignants est en grande partie responsable de la désertion de la profession. Il manque aujourd’hui 100 000 infirmières sur tout le territoire, et les statistiques indiquent que la durée moyenne de la vie professionnelle d’une infirmière est de 10 ans.
Au lieu de les traiter comme des partenaires, les médecins s’adressent aux infirmières comme à des auxiliaires. Les aides-soignantes reprochent aux infirmières de ne pas les aider dans leur « nursing » : le « sale boulot ». Tâche qui consiste à changer des malades, à les laver ou à les accompagner aux toilettes. Les cadres administratifs, toujours en réunion, jamais sur le terrain, à côté des soignants, sont l’objet de critiques constantes.
Aller vers l’autre ne va pas de soi
Dans un monde qui valorise l’efficacité technique, la rentabilité, les loisirs, le chacun pour soi, il devient de plus en plus difficile de défendre les valeurs du soin, le don de soi, la disponibilité à celui qui souffre. Ceux qui tentent encore de les préserver souffrent du peu de reconnaissance de leur engagement. Le syndrome d’épuisement professionnel, que les Anglo-saxons ont été les premiers à identifier sous le nom de burn-out désigne l’ensemble des symptômes dont souffrent les professionnels de santé, confrontés à la misère d’autrui, et « consumés » par leur travail.
4. Irriguer l’humain
Sadek Béloucif, membre du Comité consultatif national d’éthique m’a parlé de pépites – ces médecins ou infirmières qui rayonnent d’humanité, ces résistants qui relèvent un triple défi : préserver une certaine conception de l’humanité au sein du système de santé, donner des repères dans une société qui en manque de plus en plus, et enfin transmettre à d’autres leur savoir humain.
Simone Brévan, infirmière dans une équipe de soins palliatifs assume une formation à l’hôpital : « Dans les groupes que j’anime, les soignants sont avides de repères ontologiques. Qu’est-ce qui donne un sens à ma vie, à mon travail ? Peut-on soigner sans aimer ? Que suis-je face à ce patient malade ou mourant ? Dès qu’on évoque ces questions, les soignants respirent. "Ah ! On peut aussi parler de ça ? On n’est pas là uniquement pour parler de la technique du soin ?" ».
Ces lieux qui s’humanisent
Jean-Luc Meyer est à l’origine d’un projet de regroupement de deux maternités privées de Clermont-Ferrand en une seule qui assurera 3000 accouchements par an. Ce sera la 2e maternité de France. En le rencontrant, j’ai compris qu’on pouvait concevoir un projet dans lequel l’excellence technique, la sécurité des femmes et de leur bébés seraient compatibles avec une écoute, un respect et un « souci de l’autre ». Il m’a dit : « J’ai fait des expériences amusantes. Par exemple, j’ai constaté que le seuil de la douleur chez une femme apeurée, stressée, est très bas. Quand j’arrive calme et souriant, son agressivité tombe, et le seuil de la douleur s’élève.
L’allaitement artificiel et la péridurale, c’est un confort pour les soignants, mais certaines femmes le vivent comme une perte … C’est la même chose pour l’allaitement. Il y a 5 ans, 40 % des femmes allaitaient, maintenant elles sont 60 %. Cela nécessite de passer du temps avec la maman pour le premier allaitement, et de la suivre pendant les 3 premiers jours, toujours difficiles. »
Patrick Pelloux, médecin au service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine fait partie de ces résistants qui continuent à considérer que le patient est au centre des soins. Je le suis quelques heures dans son service, et je vois bien comment par sa seule manière d’être, chaleureuse et ouverte, il transforme l’atmosphère. Ses infirmières l’appellent « papa ». En effet il a quelque chose de protecteur. Accepter de reconnaître le dément comme un être qui éprouve des sentiments, même s’il ne l’exprime plus verbalement, qui peut encore avoir des éclairs de lucidité, c’est « reconnaître l’humanité et la dignité inaltérable de tout être humain ». On pense à ces mots de Christian Bobin, dans La présence pure – 1999 : « C’est par les yeux qu’ils disent les choses, et ce que j’y lis m’éclaire mieux que les livres. »
5.Une culture du soin
Que l’on soit soignant ou soigné, nous avons tous un rôle à jouer, une pierre à apporter dans la construction d’un système de santé plus humain. On devrait, au lieu d’interdire toute réaction sensible aux soignants, les aider à travailler avec, à les gérer. Mais cette culture-là n’existe pas encore dans notre Assistance Publique.
La formation des médecins à la relation humaine
Nos facultés de médecine forment d’excellents scientifiques, mais la formation à la relation humaine y est quasiment inexistante. Alors que les futurs médecins vont être, pour la plupart, confrontés à l’angoisse, à la souffrance humaine, à la crainte de mourir de leurs malades, ils ne reçoivent aucune formation psychologique ou éthique les préparant à ce face à face. Denis Labelle qui a écrit Tempête sur l’hôpital – 2002, suggère que la formation des futurs médecins, infirmières et même directeurs d’hôpital se termine par un stage où les étudiants fassent pendant quelques jours l’expérience d’être hospitalisé. « Cela rendrait les administratifs beaucoup plus soucieux du confort et plus inventifs, les médecins plus humains et moins prescripteurs d’examen, les infirmières plus silencieuses et encore plus respectueuses des patients. L’idée fait toujours sourire. Je la crois pourtant essentielle tant humainement qu’économiquement. »
De la responsabilité des chefs de service
Les soignants et les malades le disent : si le chef de service, si les responsables ont perdu le sens de l’humain, le climat d’un service en pâtit et les malades ne se sentent pas traités comme des personnes. C’est d’abord aux chefs de service qu’incombe la responsabilité de valoriser l’humain dans les soins. Ce sont eux qui donnent le ton, leur exemple est primordial.
La réflexion éthique
L’Espace éthique de l’AP–HP, dirigé et créé par Emmanuel Hirsch, est un lieu d’échange, de rencontre et de formation où médecins et soignants viennent réfléchir aux valeurs qui sous-tendent leur action. En quelques années, ces valeurs ont beaucoup évolué. « A la guérison à tout prix, on oppose la qualité de vie, au secret, le partage de la vérité, à la légitimité du médecin, celle du patient qui entend participer à la décision », écrit Marianne Gomez.
Dans ces discussions, chacun apprend de l’autre, vérifie ou infléchit ses intuitions. Les participants travaillent à partir d’histoires vécues. Comme moi, Emmanuel Hirsch a constaté que les soignants qui travaillent en soins palliatifs rapportent tous des histoires témoignant qu’un rapport assez fort s’est établi entre eux et les malades. Cette culture maison, Emmanuel dit la trouver dans certains hôpitaux privés ou en province. Là, « il y a une espèce de sagesse partagée. On ne cherche pas midi à 14 heures, il n’y a pas de comité d’éthique, on sait qu’on cherche à bien faire, le mieux possible ».
6. Vers une humanité réciproque
Un nouveau modèle de relation entre ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir médical et ceux qui, dans leur vulnérabilité, s’adressent à ce savoir et à ce pouvoir est en train de se mettre en place. Signe d’une maturité nouvelle, les malades demandent plus de partage et d’information dans la conduite de leur traitement.
La confiance est-elle en péril ?
La médecine, jusqu’à maintenant, avait une obligation de moyens ; sa puissance actuelle fait qu’elle a une obligation de résultats. Désormais le principe dit de précaution et l’obsession du risque zéro oblige le médecin à prendre toutes les garanties. Les médecins se plaignent de perdre la confiance de leurs patients. Mais ont-ils envisagé celle qu’ils pourraient à leur tour leur accorder ? S’ils s’intéressaient davantage à la personne du malade, s’ils pouvaient s’asseoir auprès de lui et laisser venir ses questions, cette attitude serait un véritable cadeau pour le malade. Le patient pourrait évoluer d’une confiance aveugle vers une confiance adulte et partagée.
S’ils comprennent mieux, les patients adhéreront plus facilement aux propositions thérapeutiques qui leur sont faites. Ils courront moins d’un médecin à l’autre pour chercher un avis supplémentaire, ils seront moins tentés de déposer plainte. Bien souvent, ce n’est pas tant l’information qui fait défaut qu’une certaine qualité de communication. Il serait vraiment regrettable que l’information se réduise à des dispositifs strictement procéduriers.
De la plainte à la conciliation
Il n’est pas rare qu’un soignant change sa manière d’être lorsqu’il a pris conscience de son impact sur les malades. Les premiers postes de conciliateur datent des années 1980. La loi impose maintenant aux établissements de santé d’avoir leur commission de conciliation.
Vers une coresponsabilité de la relation
Si j’exige d’un médecin qu’il m’écoute et me respecte, qu’il m’informe et tienne compte de moi, je dois de mon côté lui accorder la même attention. Si j’exige une disponibilité absolue au mépris des autres patients, si je les rends responsable de tout ce qui ne va pas sans faire la part des choses, alors mon attitude est arrogante. Elle n’est pas humaine. La même réciprocité est valable à l’égard des infirmières. Celles-ci s’occupent de choses dont nous ne voulons pas entendre parler et que nous occultons : la vieillesse, la déchéance physique ou mentale, la misère, la folie, la mort. Nous ne savons pas ce qu’elles vivent et nous sommes peu conscients de leurs conditions de travail. L’humanité des soins n’incombe pas seulement aux soignants. Soignants et soignés sont coresponsables de la relation de soins. Chacun doit savoir se mettre à la place de l’autre.
Ces malades qui soutiennent les soignants
Une infirmière auprès d’enfants cancéreux écrit : « Une maman, une nuit, qui veillait auprès de son enfant qui mourait, m’a dit d’aller manger quelque chose, parce que je n’avais pas eu le temps de dîner. C’est une attention dont je me souviens encore. » Bien des malades conscients de la charge de travail des soignants, aident ainsi leurs voisins de chambre, parfois plus démunis qu’eux. C’est cette solidarité entre malades qu’il nous faut développer, puisque les soignants ne peuvent pas être sur tous les fronts.
Ai-je vécu une utopie ?
J’ai eu la chance, pendant 10 ans, de travailler comme psychologue au sein d’un service humain. Il accueillait les plus vulnérables de nos malades, ceux que la médecine ne peut plus guérir, et qui se sentent si souvent exclus du monde de la santé. On parlait, on riait, on pleurait, on savait se taire et consoler. Il y avait des êtres humains qui affrontaient ensemble ce moment fort de la vie qui est sa fin. À l’origine de ce service pilote – il s’agit de la première unité de soins palliatifs de France – il y a un homme auquel il convient de rendre hommage. Je dis bien un « homme », avant de dire un médecin, parce que c’est précisément sa qualité d’homme, d’être humain soucieux de l’autre humain, qui a toujours prévalu dans le combat qu’il a mené pour humaniser l’hôpital : Maurice Abiven décrit lui-même dans Humaniser l’hôpital – 1976, et Pour une mort plus humaine – 1997, qu’il a toujours été profondément choqué par le mépris qu’il percevait chez ses confrères à l’égard du malade.
Il avait observé que, lorsque médecins et infirmières se réunissaient pour parler des malades, pour confronter leurs points de vue, le regard de l’équipe sur ceux-ci changeait, s’humanisait. Les patients eux-mêmes le sentent et le disent. Nous avons appris à faire une place à l’affectif, à l’accepter comme une dimension naturelle. Et nous avons constaté que cette reconnaissance de l’humanité des soignants est en soi un garde-fou.
Nous avons institué l’habitude de nous réunir pour échanger, pour penser notre pratique, pour mettre en commun nos difficultés. Si chacun se mettait ne serait-ce qu’une seconde à la place de l’autre, il y aurait plus de respect. On ouvrirait la porte que doucement, on enverrait un signe d’accueil, un sourire, tendre la main, on parlerait moins fort.
Au terme de l’enquête que j’ai menée, je suis persuadée que, même si la réalité économique nous éloigne tous les jours un peu plus de l’humain, nous pouvons tous, chacun à notre place et à notre niveau, nous battre pour nous apporter les uns les autres cette humanité à laquelle nous croyons et à laquelle nous aspirons.
Dans son rapport « Ethique et professions de santé » remis à Jean-François Mattei en mai 2003, Alain Cordier insiste sur l’éveil des consciences. Un éveil qui concerne tout le monde. Pas seulement les acteurs du monde de la santé, mais les malades, les familles. La réflexion éthique appelle chaque soigné autant que chaque soignant. Il faudra toujours s’interroger sur les voies et les moyens de les faire progresser ensemble.
C’est à cette interrogation que j’ai tenté d’inviter le lecteur. L’humanité de l’hôpital ne passe pas seulement par des solutions (plus de temps pour les soignants, formation à l’écoute et au dialogue) mais par un processus de prise de conscience.
« A travers les évolutions du passé, il est malgré tout concevable d’envisager avec une certaine confiance un futur aux contours certes encore difficilement définissables, mais qui favoriserait une intelligence collective, une ouverture créative. Il s’agit en fait d’appréhender un processus davantage que des solutions » a dit Jonathan Mann. Emmanuel Hirsch a repris sa phrase en exergue de son dernier livre.