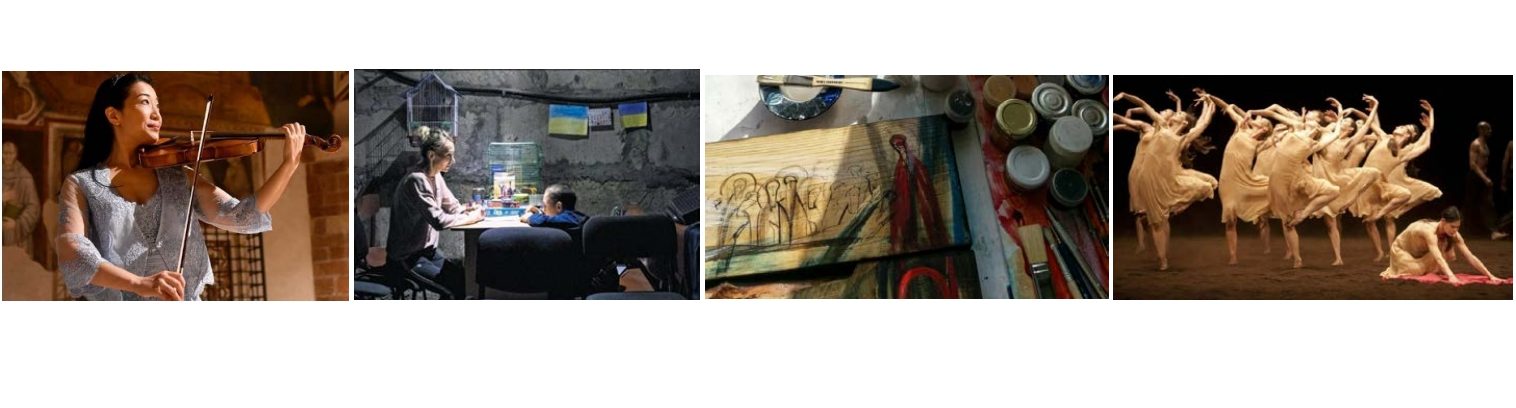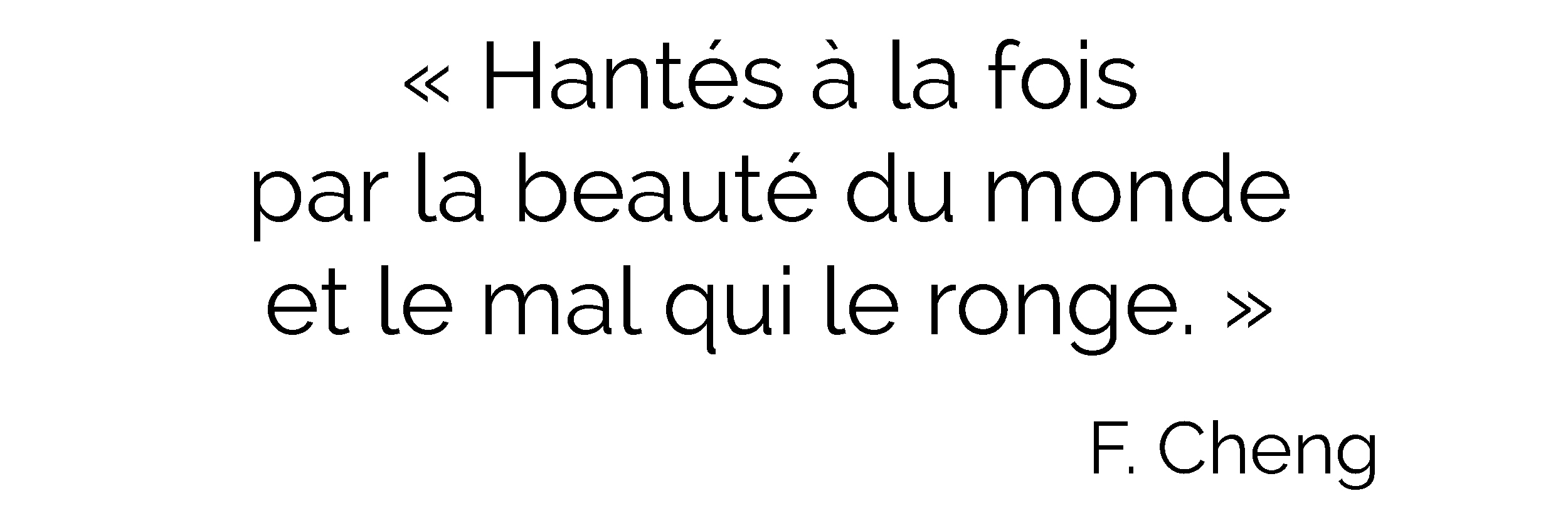« Nous embarquerons-nous sur cette frêle barque ? » Ainsi présentée, c’est sûr que « la frêle barque » ne nous donnerait guère envie de nous y embarquer. Pour nous autres, les enfants d’Ève, pour nous autres qui aimons bien assurer nos arrières et nous réfugier derrière nos assurances, l’invitation à monter sur une « frêle barque » ne nous incite pas vraiment à nous y risquer. Mais quelle est-elle, cette frêle barque que Charles Péguy nous propose au cœur de son poème Ève ? Ce poème est sans conteste le plus long de l’écrivain : il compte presque 8000 vers au cours desquels le poète déploie l’histoire de l’humanité vue comme l’histoire du Salut. Ainsi, les quatrains s’enchaînent et soudain s’arrêtent autour du berceau de l’Enfant Jésus. La nacelle dont il est question est le premier berceau de l’Enfant-Dieu, elle unit l’arche d’alliance et celle de Noé, elle annonce la barque de l’Eglise. Dans le premier vaisseau, dort le petit Enfant. Et cette barque de bois, cette coquille de noix, pourtant, est celle qui doit traverser les mondes pour nous faire arriver à bon port.

Eugène Delacroix, 1853, Metropolitan Museum of Art, New York, États-Unis.
Tout avait commencé avec un naufrage. Dès les premiers vers de cette vaste épopée de l’histoire humaine que constitue Ève, le paradis est perdu. Jésus s’adresse à Ève, son illustre aïeule, pour déplorer la perte de la grâce, la disparition de la douceur du premier jardin à cause du premier péché.
Et par là vous savez pourquoi l’homme s’observe.
C’est qu’il a toujours peur de trop donner à Dieu.
Il bâtirait mon temple en boîtes de conserve
Et du bois de la croix allumerait son feu.
Seule vous le savez, nos vertus d’aujourd’hui
Ne valent pas le quart de l’antique innocence.
Et les moralités de notre morne ennui
Ne valent pas le quart de l’antique puissance.
Seule vous le savez, nos plus beaux sentiments
Ne durent jamais plus que l’espace d’un jour.
Et l’amour le plus ferme et le plus dur amour
Ne dure jamais plus que de quelques moments.
Seule vous le savez, nos imprécations
Ne se lèvent jamais que quand il est trop tard.
Quand le crime est passé le long du boulevard,
Alors nous soulevons nos proclamations [1]Eve, Charles Péguy
La description de ce premier monde évoque les « naissantes années », l’abondance infatigable des blés et « les jours de bonheur se suivant à la file » mais toutes ces images sont marquées par la perte et une perte irrévocable. C’est Dieu le Père lui-même qui se trouve à considérer sa création avec anxiété, voyant, de son regard paternel, « le monde appareiller au seuil de ce naufrage ».
Pour nous, il n’est pas nécessaire de déborder d’imagination pour avoir non seulement l’intuition mais encore une certaine expérience dudit naufrage : il suffit d’ouvrir les yeux et de regarder en nous et autour de nous. Péguy, cependant, dans la première partie de son poème, déploie une créativité infatigable et pleine d’humour, pour nous donner à voir l’ampleur du désastre (et parfois pour nous permettre d’en rire).
Et par là vous savez pourquoi l’homme s’observe.
C’est qu’il a toujours peur de trop donner à Dieu.
Il bâtirait mon temple en boîtes de conserve
Et du bois de la croix allumerait son feu.
Seule vous le savez, nos vertus d’aujourd’hui
Ne valent pas le quart de l’antique innocence.
Et les moralités de notre morne ennui
Ne valent pas le quart de l’antique puissance.
Seule vous le savez, nos plus beaux sentiments
Ne durent jamais plus que l’espace d’un jour.
Et l’amour le plus ferme et le plus dur amour
Ne dure jamais plus que de quelques moments.
Seule vous le savez, nos imprécations
Ne se lèvent jamais que quand il est trop tard.
Quand le crime est passé le long du boulevard,
Alors nous soulevons nos proclamations [2]Ibid
La comparaison systématique de l’antique pureté et de la première liberté avec notre condition actuelle ne joue jamais en notre faveur. Ce que les nombreuses strophes de cette partie du poème s’attachent à montrer, c’est non seulement nos mesquineries, nos radineries, nos petitesses et nos vilenies mais aussi notre hypocrisie et nos risibles prétentions à être des gens de bien. Est-ce alors le moment où l’on arrête de lire Ève, se détournant résolument d’un texte qui chercherait à noyer son lecteur dans la culpabilité ? Ce serait passer à côté de l’humour qui, comme une sorte de « tendresse mouillée », (pour reprendre les mots de Péguy) habite le texte. Ce serait surtout passer à côté de l’intention de ce poème qui est d’être une épopée.
C’est en tous cas comme cela que Péguy considère son œuvre. Or, la caractéristique première de ce genre littéraire très ancien n’est certainement pas de faire plonger son lecteur dans les abysses de la culpabilisation ou d’une certaine autoflagellation. Bien au contraire, ce qui anime la composition d’une épopée est le désir de montrer une collectivité qui entoure un héros et trouve, autour de lui et de ses exploits, son unité. L’enjeu d’une épopée, c’est encore de retrouver, de refonder une communauté qui soit unie et assurée afin de l’embarquer pour de grandes aventures.

Lorenzo Veneziano, Christ marchant sur les eaux
« Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble chez le Bon Dieu », s’exclamait la petite Jeannette dans Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc, une pièce de théâtre dont la première version est publiée par Péguy en 1897. Derrière le cri de celle qui deviendra la « pucelle d’Orléans », on entend toute la révolte de Péguy face à l’idée de l’Enfer. C’est ce scandale qui, lors de ses études à Paris, le pousse à s’éloigner de l’Eglise catholique et de la foi de son enfance. Il se tourne alors vers un socialisme qui veut construire une collectivité sans dehors, une cité sans exclusion, une société qui soit vraiment « à nous », et à nous sans exception ! Pour Péguy, refuser l’idée de l’Enfer, c’est refuser de laisser des hommes et des femmes, des frères et sœurs, « en dehors », comme « éternellement en dehors ». On connaît le rôle que joue alors « la petite Espérance » sur le chemin de Péguy, lui permettant finalement d’écrire à son ami Joseph Lotte en 1908 : « J’ai retrouvé ma foi : je suis catholique ». Tout se passe comme si la « petite fille Espérance [3]Le porche du mystère de la seconde vertu, Charles Péguy » l’avait pris par la main, le conduisant à un apaisement progressif et ouvrant la possibilité « d’espérer pour tous » (pour reprendre le titre de l’ouvrage de Hans Urs von Balhasar). C’est peut-être pour cela que le « nous » qui se dessine au long de l’épopée finale de Péguy [4]Ève est publiée à la Noël 1913, quelques mois avant sa mort en septembre 14 se veut le plus ouvert, le plus large possible. Le vieux rêve du Péguy socialiste organisant des réunions avec ses camarades dans sa chambre rebaptisée « thurne Utopie » était celui d’un « nous » sans dehors. C’est bien ainsi qu’il va se dessiner dans Ève, comme un « nous » extrêmement ouvert, extrêmement large, comme les horizons qui s’ouvrent à nouveau, à partir de la présence de l’Enfant-Jésus, venu nous sauver dans notre « commun péril ».
Il allait regagner l’énorme récompense.
Il allait commencer l’énorme sauvetage.
Il allait nous ravoir notre énorme héritage.
Et nous faire lever l’éternelle suspense.
Il allait nous sauver dans ce commun péril.
Il allait commencer quel immense partage.
Il allait nous gagner quel immense avantage.
Il allait commencer quel éternel avril.
Cette nacelle était comme un bateau gréé.
Nous embarquerons-nous sur cette frêle barque.
Accompagnerons-nous notre premier monarque,
Notre amiral des mers sur son bateau paré [5]Eve, Charles Péguy