A l’occasion du centenaire de sa naissance, le Centre Pompidou a consacré une rétrospective au deuxième Président de la Vème République, disparu prématurément en 1974. On connaît l’homme politique brillant, identifié aujourd’hui à la nostalgie des années de prospérité. On connaît moins l’homme de lettres passionné d’art contemporain, et l’homme de cœur.
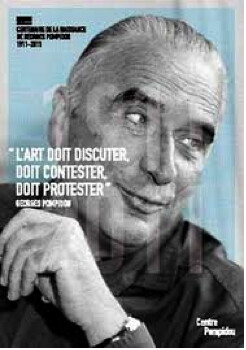
Affiche au Centre Pompidou 2011
Lorsque le Général de Gaulle nomme Georges Pompidou Premier Ministre en avril 1962, le nouveau locataire de l’hôtel Matignon est inconnu du grand public. Il a pourtant déjà une longue carrière derrière lui, et il fréquente le Tout-Paris. C’est un authentique homme du peuple, produit de la méritocratie républicaine : né à Montboudif (Cantal) dans une famille paysanne, fils d’instituteur, élève au lycée d’Albi, normalien, agrégé de lettres, il enseigne à Marseille puis au Lycée Louis-le-Grand à Paris, où il côtoie Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.
A la Libération, il souhaite faire autre chose qu’enseigner rosa la rose toute sa vie et se rendre utile à un moment ou le pays se reconstruit. Son ami René Brouillet, autre normalien, le fait entrer au cabinet du Général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, dont il devient l’homme de confiance. Il accompagnera le chef de la France Libre dans sa « traversée du désert », dirigeant bénévolement la fondation Anne-de-Gaulle créée par le général au profit des enfants handicapés. Parallèlement, il poursuit sa carrière au Conseil d’Etat puis à la Banque Rothschild. En 1958, de Gaulle revenu à la tête du gouvernement en fait son directeur de cabinet. Après avoir refusé le ministère des finances et accompli différentes missions secrètes dans l’affaire algérienne, il est finalement nommé Premier Ministre en 1962. Il le restera jusqu ‘en 1968, battant un record de longévité jamais égalé à Matignon. Il dote alors la France d’une politique industrielle ambitieuse : c’est l’époque des taux de croissance à 5%. Mais c’est en 1968, face à la révolte de mai, qu’il donne toute sa mesure en évitant l’effusion de sang. Si de Gaulle est l’acteur de la sortie de crise, Georges Pompidou en est le concepteur. Les Français ne s’y trompent pas: écarté de Matignon par le général qui prend ombrage de sa popularité, il est élu triomphalement Président de la République l’année suivante avec 58% des voix. Sa présidence, précédant de peu la première crise pétrolière, est marquée par une prospérité record: aujourd’hui encore, on parle avec nostalgie des « années Pompidou », synonyme de hausse du niveau de vie, de bagnole, d’électroménager et de plein emploi. Atteint de la maladie de Waldenström, Georges Pompidou s’éteint le 2 avril 1974, à 62 ans, non sans avoir préalablement poussé sur le devant de la scène deux de ses collaborateurs appelés à un grand avenir: Jacques Chirac et Edouard Balladur.

Sonia Delaunay, Rythme, 1938 CC BY *clairity*
On savait Pompidou homme de lettres : n’avait-il pas publié en 1961 une Anthologie de la poésie française que l’on trouve encore en livre de poche ? Sa passion pour l’art moderne sera vraiment connue après sa mort, au fur et à mesure que s’élèvera… le centre Pompidou, Beaubourg. Ce centre culturel pour Paris, c’est lui qui l’a voulu, inaugurant ainsi la politique de « grands travaux » présidentiels dans la capitale. Il souhaitait mettre l’art contemporain à la portée de tous : « Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel (…) qui soit à la fois un musée et un centre de création où les arts plastiques voisineraient avec la musique, le cinéma, les livres, la recherche audiovisuelle », disait-il. Il était convaincu qu’une société qui s’ouvre à l’art de son temps est une société plus apte à changer et à se moderniser et qu’« il n’y a pas de culture sans remise en cause des idées reçues ». En fait de remise en cause des idées reçues, les Parisiens allaient être servis. En voyant s’élever le monstre multicolore de verre et d’acier, avec ses tuyaux semblables à ceux d’une usine, nombre d’entre eux se demandèrent si c’était là une armature provisoire qui allait disparaître. Las ! L’armature est restée, et on aurait maintenant du mal à imaginer Paris sans Beaubourg, comme sans la Tour Eiffel. Comment cet homme plutôt conservateur en matière de politique et de mœurs a-t-il pu bousculer les normes architecturales de son époque, à tel point que son successeur Valery Giscard d’Estaing, lors de l’inauguration du monstre en 1977, veillera à garder ses distances avec les goûts de son prédécesseur et fera disparaître de l’Elysée le salon contemporain qu’il y avait aménagé ? C’est que le personnage était complexe: il y avait le Pompidou paysan, qui passait ses vacances dans une bergerie du Lot, qui aimait saluer les gens à la sortie de la messe, et le Pompidou esthète, amateur de galeries d’art, collectionneur, familier de Max Ernst et de Sonia Delaunay, fréquentant le Saint-Tropez des années 60. Etait-ce le même homme qui prétendait garder le contrôle de l’information télévisée sous prétexte qu’elle était « la voix de la France », et déclarait en même temps que « l’art doit discuter, contester, protester… [Il] est l’expression d’une époque, d’une civilisation (…), le meilleur témoignage que l’homme puisse donner de sa dignité… L’art est toujours plus ou moins une remise en question des choses.»
Il y a un mystère Pompidou, qu’il entretenait avec soin. Peu après son élection à la Présidence de la République en 1969, il fut interrogé lors d’une conférence de presse sur un fait divers de l’époque. Gabrielle Russier, enseignante de lettres, s’était suicidée après avoir été inculpée de détournement de mineur, à la suite d’une liaison avec un de ses élèves. C’était la « révolution 68 » qui était soumise à son jugement. Enigmatique, après un long silence, visiblement ému, Georges Pompidou répondit en citant Eluard :
Moi, mon remords, ce fut
la victime raisonnable
au regard d'enfant perdue,
celle qui ressemble aux morts
qui sont morts pour être aimés.
Michel Charasse, collaborateur de François Mitterrand, raconte que vers la fin de sa vie, l’ancien président socialiste fit un jour arrêter sa voiture devant la mairie de Montboudif. Après un moment de méditation, il l’entendit dire : « Quand même, quel destin ! »








