Quelques semaines avant d’être choisi comme tête de liste du parti « Les Républicains » pour les élections européennes, François Xavier Bellamy, jeune professeur de philosophie, conseiller à la municipalité de Versailles, qui s’était fait connaitre du grand public par son livre « Les déshérités », publiait un essai sobrement intitulé « Demeure ». Un titre mystérieux certes, mais son livre en dit long sur le projet politique qu’il porte.
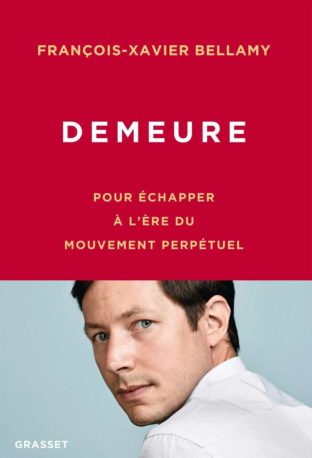
Se procurer le livre en ous soutenant : ici.
Refusant l’étiquette de « conservateur » (réservons le à l’industrie agro-alimentaire) il affirme dans son essai précis, poétique et pédagogique, l’urgence de retrouver des repères dans un monde en perpétuel mouvement.
Alors que la marchandisation progresse et que tout entre dans le grand mouvement du marché (jusqu’au corps humain, on pourra bientôt louer un ventre pour une GPA), alors qu’on fait aujourd’hui de la politique une course vers l’avant où le gagnant est celui qui s’adapte à l’ère du temps (avec des slogans qui appellent au mouvement comme « le changement c’est maintenant » ou « en marche » pour prendre des recettes qui ont connu un certain succès), alors que la mode, la technologie, tout s’accélère et qu’il faut être en perpétuel mouvement sous peine d’être réactionnaire ou « demeuré », alors que la réalité économique exige la mobilité professionnelle et que le voyage devient une industrie au point de parler de tourisme de masse (il faut partir le plus souvent possible et le plus loin possible pour être dans le vent)… il est urgent de retrouver le sens de ce mouvement perpétuel. La réponse à cette course frénétique pour être partout en même temps n’est évidemment pas dans l’immobilisme, mais dans un retour au pourquoi : pourquoi cours tu ? Où vas-tu ? Que cherches tu en fait ?
Car le mouvement perpétuel, cette course dans laquelle nous sommes entrainés (bien naïf celui qui pense y échapper) est souvent, justement, une fuite en avant : « Non le mouvement perpétuel ne nous comble pas, au contraire ; il révèle notre vide intérieur ». Aller de l’avant c’est bien quand on est sur un chemin qui nous emmène vers notre destination, mais ce n’est pas en soi une valeur ; au bord d’un précipice crier « en marche ! » c’est plutôt fatal. L’ère du mouvement est marquée par l’idéologie du progrès : on trouvera demain les réponses technologiques aux problèmes d’aujourd’hui ; par l’effet grisant de toute puissance que donnent les nouvelles technologies : toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus connecté…mais en réalité quand on regarde les chiffres : toujours plus de temps dans les transports, toujours plus de solitude dans nos sociétés. On assiste ainsi à une perte généralisée des repères puisqu’on refuse de se demander d’où l’on vient et on l’où va (comme l’illustre le discret glissement de vocabulaire : on ne parle plus d’immigrants ou d’émigrés, il n’y a plus qu’une anonyme masse en mouvement des migrants). Elle aboutit à l’impératif catégorique darwinien d’évoluer en permanence, d’épouser le mouvement, de tout changer tout le temps, de s’adapter ou mourir.
Mais cet impératif nous fait oublier que tout mouvement n’est pas forcément un progrès et que l’adaptation ne peut être une valeur en soi. Cela est particulièrement visible en politique où la seule règle qui semble aujourd’hui prévaloir est celle-ci : de toute manière ces changements vont arriver, on ne peut lutter contre le progrès… ils doivent arriver ; il est donc nécessaire qu’ils adviennent. Et la boucle est bouclée, on ne peut lutter contre le progrès, le marché, la science. Une telle attitude enlève toute marge de manœuvre et toute dignité à l’action politique ; quand on commence par dire : vous comprenez la mondialisation, l’Europe, la concurrence, la situation… on ne peut terminer que dans le fatalisme. « En réalité le progressisme n’est pas une option politique mais une neutralisation de la politique ». Et c’est un aspect particulièrement intéressant de « Demeure » : il tente de redonner le sens et surtout la confiance dans l’action politique : « il ne suffit pas de vouloir « avancer » ou « marcher » ou « faire » : de tels slogans ne sont pas des maximes valables pour la vie politique – ils sont plutôt le symptôme de sa dissolution ». Il n’y a pas d’avenir tout tracé, une politique est encore possible, l’Etat n’a pas pour mission d’être une start-up qui doit offrir un produit adapté au marché, suivre l’air du temps, mais il est étymologiquement « stat », celui qui se tient, qui est, qui reste, qui demeure et est le garant de ce que nous transmettrons à nos enfants. Depuis quelques années les slogans politiques sont passés de la « rupture », à la « réforme », pour arriver aujourd’hui à la « transformation » de l’économie, de la société, du pays. Mais que veut on sauver ? Qu’est ce qui mérite de demeurer ? Un homme politique devrait il défendre son bilan seulement sur les réformes entreprises ou aussi sur ce qu’il a réussi à préserver ? Le débat politique se concentre sur la question : « comment s’adapter ? », alors que la politique admet aussi, sans fatalisme, la question « que voulons-nous ? »
A l’ère du mouvement perpétuel, de la fuite en avant, l’homme a plus que jamais besoin d’une destination, d’une direction: il n’est de véritable progrès seulement si quelque chose demeure, vers lequel nous pouvons tendre ; il n’est de chemin que vers une destination qui ne peut être simplement politique (l’aube rougeoyante du communisme ou de l’en-marchisme ?), technologique (la vie quasi-éternelle que veut offrir le transhumanisme ?), économique (un salaire minimum pour le genre humain ?) mais transcendantal : nous voulons le beau, le bien, le vrai, la justice. La demeure dont parle Bellamy n’est pas seulement un toit, mais ce quelque chose d’unique qui donne sens à la vie : « l’homme n’a pas seulement besoin de se loger, mais plus encore d’habiter ; rien n’est plus uniforme que le « logement » ; rien n’est plus singulier que le foyer. Et rien n’est plus nécessaire à l’homme que ce foyer singulier autour duquel s’organise le monde entier » ; « Cela prend du temps pour qu’un logement devienne demeure ». Cette demeure, ce point d’appui que nous cherchons, est justement ce qui n’est pas soumis à l’humeur du temps ou aux mouvements de la politique ; cette demeure échappe aux lois du marché elle est donc ce qui n’a pas de prix, ce que nous voulons contempler et non saisir : « Contempler le réel c’est renoncer pour un temps à le transformer. Ce temps donné à la contemplation est aujourd’hui le seul choix qui puisse sauver notre monde en nous sauvant du déni dans lequel nous entraine la fascination pour notre propre pouvoir ».
C’est pourquoi, plus que jamais nous avons besoin de la poésie, de gratuité : « De ce fait, il peut sembler étonnant que la littérature soit désignée comme une réponse bien concrets qui ont été évoqués dans ces pages : l’attitude poétique est généralement perçue comme dépourvue d’effet, incapable d’efficacité matérielle. La langue qui décrit le réel n’ajoute rien au réel qu’elle décrit. Dans son usage poétique en particulier, elle ne permet aucune action : elle éveille seulement notre attention aux réalités présentes. Mais c’est justement pour cela que la poésie est plus nécessaire que jamais : car pour résoudre la crise que nous rencontrons aujourd’hui nous avons moins besoin d’action que d’attention retrouvée – non pour arrêter l’action, mais pour lui redonner sens, en la dirigeant vers ce qui mérite que nous y soyons attentifs, et en protégeant ce qui mérite que nous y fassions attention ».









